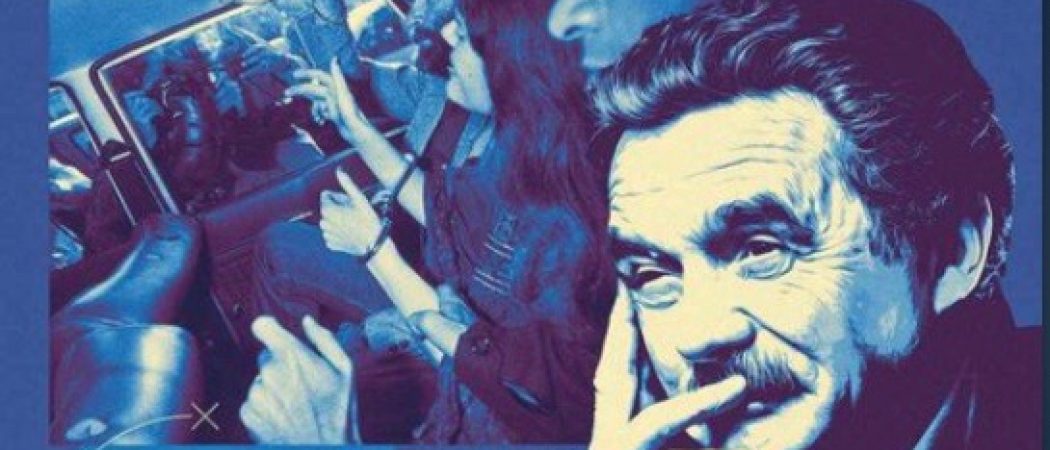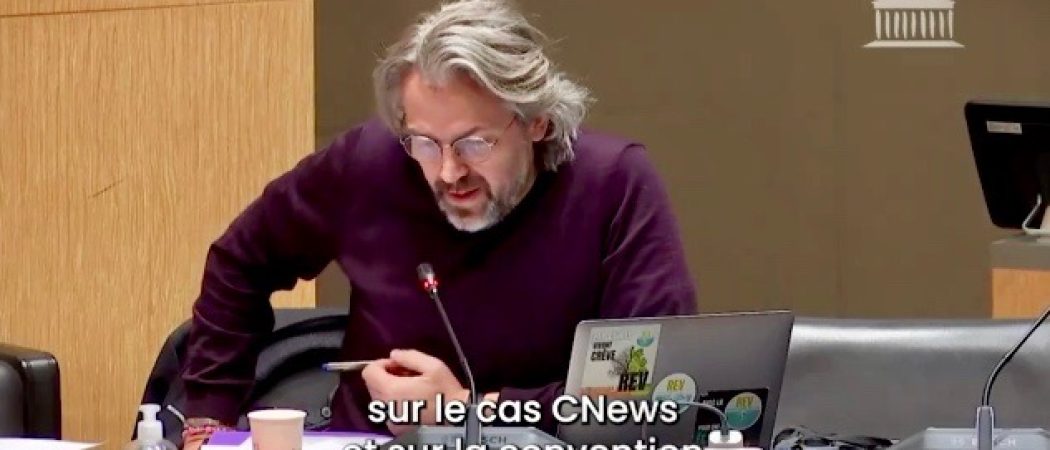À la une
GENEVE – Le gouvernement suisse organisera les 15 et 16 juin une conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine, à laquelle la Russie a déjà prévenu qu’elle ne…
- Avec Reuters
- 17 avril 2024
NANTES : Les élus de la majorité présidentielle dénoncent le rétropédalage de la Présidente de Région sur la tarification sociale des cantines. La Présidente de la Région des Pays de…
- 16 avril 2024
Après les multiples départs du parti Reconquête depuis la campagne de l’élection présidentielle, dont l’un des plus récents est Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, parti rejoindre Florian Philippot et les…
- Rédaction Média-Web
- 12 avril 2024
WASHINGTON (Reuters) – Le président américain Joe Biden a déclaré mercredi qu’il examinait la demande australienne d’un abandon des poursuites engagées par les Etats-Unis contre Julian Assange, à l’origine d’une…
- 11 avril 2024
La triple championne olympique Marie-José Pérec fait partie des huit personnalités sélectionnées pour embarquer à bord du bateau Maxi Banque Populaire XI à l’occasion du relais de la flamme olympique,…
- Avec Reuters
- 8 avril 2024
Sommes- nous si démunis pour prévenir la violence, protéger et « réparer » la souffrance des victimes ? Non seulement l’école ne peut rien faire seule. Mais l’école ne DOIT rien faire seule…
- Tribune libre de Michèle Adam
- 8 avril 2024
Officiellement sélectionnés depuis le 14 mars pour représenter la France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 l’été prochain, Camille Lecointre et Jérémie Mion ont décroché la victoire, ce samedi, dans le…
- 6 avril 2024
Des perquisitions ont eu lieu mercredi à l’hôtel de ville du Havre et au siège de la communauté urbaine dans le cadre d’une enquête du parquet national financier (PNF). Le…
- Avec Reuters
- 3 avril 2024
Numéro deux de la liste du Rassemblement National pour les élections européennes, Malika Sorel, lors d’une interview donnée sur Europe1 et Cnews, n’hésite pas à mettre « les pieds dans le…
- Tribune de Jean Goychman
- 3 avril 2024
Présenté comme un vecteur de dynamisme rural, le Tour cycliste des Pays de la Loire est lui aussi mentionné dans les mesures phares des actions au profit de la ruralité.…
- 1 avril 2024
Alors que depuis des semaines, la Fédération Nationale des Ports et Docks C.G.T. a interpellé la direction de CroisiEurope pour tenter d’aborder la nouvelle saison dans un climat social plus…
- 30 mars 2024
Les Républicains ont lancé leur campagne des élections européennes ce samedi devant près de 3 000 militants. Les ténors LR étaient présents à l’exception de Valérie Pécresse et de Bruno…
- 24 mars 2024
Le 27 avril prochain, l’UDB et son journal fêtent leur […]
- 17 avril 2024
Le Sénat a voté contre le traité Ceta. Les sénateurs […]
- 21 mars 2024
Les avocats généraux avaient requis un an d’emprisonnement avec sursis. […]
- 14 février 2024
Meeting pour une vie digne en France et dans le […]
- 31 janvier 2024
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un texte visant […]
- 30 janvier 2024
Comme pour de nombreux sujets, on entend souvent dire, à […]
- 30 janvier 2024
La mobilisation des agriculteurs est en train de s’étendre à […]
- 24 janvier 2024
Elisabeth Borne a remis la démission du gouvernement, Emmanuel Macron […]
- 8 janvier 2024
En Loire-Atlantique, un important dispositif de sécurisation et de secours […]
- 1 janvier 2024
Les opposants à l’A 69 sont satisfaits, car suite à […]
- 24 décembre 2023
» La Chaîne CNEWS n’est plus une chaîne d’information, elle […]
- 16 décembre 2023
Malgré une première édition difficile en termes de fréquentation, le […]
- 11 décembre 2023
Commentaires
-
Le 12 avril 2024 par Legovic Quimper :
« Il est certain que Monsieur Zemour n'est pas politique et encore moins madame Knafo qui a commis de nombreuses bourdes…… » -
Le 9 avril 2024 par Marie :
« Le premier ministre promet <> envers la violence des jeunes: Lesquelles? La prison? Le Ministre de la justice interroge l'excuse…… » -
Le 8 avril 2024 par Karine :
« Je ne savais pas qu’il existait tout « cet arsenal » ,mot choisi en réplique du gouvernement qui préconise «…… » -
Le 17 mars 2024 par marcos :
« trés bon article… » -
Le 14 mars 2024 par DLM :
« ‘’ Une juste répartition de l’effort sur les autres territoires ‘’ : ces élus découvrent aujourd’hui que la politique énergétique…… »
Réseau média web
Liens utiles
#Concarneau / #Angers #SCO 2 – 4 un match référence pour la suite
#SaintNazaire : l’intersyndicale (#CGT éduc,#FSU et #SUD éduc) appelle à la grève dans l’éducation le 2/04/2024
Les Rendez-vous #LaBaule reçoivent #HenriGuaino
#CroisiEurope : « la colère des salariés est toujours là, sans réponse, place à l’action ! » Déclare la #CGT